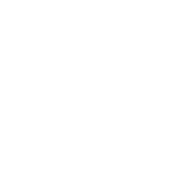Refuser d’adhérer à la « culture » de l’entreprise n’est pas un motif licite de licenciement
Dans le cadre de sa liberté d’expression, un cadre est en droit de réprouver l’habitude, présentée comme une valeur de l’entreprise, de multiplier les « pots » alcoolisés, sous prétexte de fédérer les équipes. Son licenciement, prononcé en partie pour son refus de participer à ses réunions festives est nul, peu importe que d’autres motifs aient pu être pertinents.
La Cour de cassation a jugé que la liberté d’expression ne s’exerce pas seulement en parole, mais bien aussi par des comportements significatifs. Un cabinet de conseil et de formation a développé une valeur de management dénommée « fun & pro » consistant entre autres, à instaurer un pot toutes les fins de semaine, au cours duquel l’alcool coule à flots. Cette pratique déplaît à l’un des consultants qui s’abstient de participer à ces réunions. Il reproche également, ouvertement, aux associés du cabinet, d’autres « excès ». La direction finit par le licencier en invoquant une insuffisance professionnelle et une absence d’intégration de la valeur « fun & pro ».
Pour le salarié, ce dernier motif est inacceptable, car il constitue une violation de sa liberté d’opinion et d’expression.
Au-delà du refus d’adhérer à cette méthode de management, le licenciement du salarié n’aurait rien à voir avec les critiques qu’il pouvait exprimer. Ce qui lui est reproché, c’est son comportement.
La cour d’appel de Paris va rejeter la requête du salarié, mais la Cour de cassation, plus rigoureuse sur le respect des libertés fondamentales, casse la décision : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le licenciement était, en partie, fondé sur le comportement critique du salarié et son refus d’accepter la politique de l’entreprise basée sur le partage de la valeur « fun and pro », mais aussi l’incitation à divers excès, qui participent de sa liberté d’expression et d’opinion, sans qu’un abus dans l’exercice de cette liberté ne soit caractérisé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
L’entreprise ne saurait exiger que son personnel d’encadrement soutienne inconditionnellement les choix de la direction.
Dans son arrêt, la Cour de cassation procède à un rappel salutaire. La liberté d’expression des salariés à l’intérieur de l’entreprise est très largement reconnue (Cass. soc., 8 juin 1999, n° 96-43.588 ; Cass. soc., 14 déc. 1999, n° 97-41.995, JSL du 11 janv. 2000, n° 49-2), la seule limite à l’exercice de cette liberté étant l’abus de droit : Ne sont reconnus comme abusifs que les propos injurieux (Cass. soc., 9 nov. 2004, n° 02-45.830 ; Cass. soc., 28 avr. 1994, n° 92-43.917) ou diffamatoires (Cass. soc., 16 nov. 1993, n° 91-45.904 ; Cass. soc., 7 oct. 1997, n° 93-41.747, JSL, 10 nov. 1997, n° 1 ; Cass. soc., 21 sept. 2011, n° 09-72.054, JSL, 27 oct. 2011, n° 308-8).
Pour la Cour de cassation, dès lors qu’il s’abstient de termes injurieux ou diffamatoires, un cadre peut se permettre de se désolidariser de sa direction (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734, JSL, 14 mai 2013, n° 343-3 ; Cass. soc., 23 sept. 2015, n° 14-14.021, JSL, 9 nov. 2015, n° 397-7 ; Cass. soc., 16 févr. 2022,n° 19-17.871, JSL, 5 avr. 2022, n° 539-1 ; Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-16.060, JSL, 14 sept. 2022, n° 547-2). Ainsi, il a été jugé que la liberté d’expression peut s’exercer par le biais d’un comportement.
Dans cette affaire, le consultant n’avait pas été licencié pour les propos qu’il avait pu tenir. Personne ne lui contestait le droit d’exposer son opinion. Ce qui lui était reproché, c’était son refus de participer à des réunions qui, destinées à souder les équipes, faisaient partie de ses fonctions. Dans cet arrêt, la Cour de cassation coupe court à cette argumentation tendant à réduire la liberté d’expression à l’utilisation orale ou écrite des paroles, et affirme que le comportement est une façon comme une autre de s’exprimer. Le fait de manifester son désaccord par la politique de la chaise vide relève de la liberté d’expression.
L’arrêt rappelle aussi un principe solidement établi, mais trop souvent oublié : en cas de pluralité de motifs de licenciement, si un seul est susceptible d’entraîner l’annulation, le juge n’a pas le choix : il doit prononcer la nullité (Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-40.139, JSL, 5 oct. 2009, n° 263-9, noyé au milieu d’autres raisons, figurait le reproche d’avoir participé à une grève ; Cass. soc., 3 févr. 2016, n° 14-18.600, JSL, 22 mars 2016, n° 406-2, lettre faisant état, entre autres motifs, d’une action en justice intentée par le salarié)..
La Cour de cassation exige seulement que le salarié demande la nullité à titre principal (Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 19-17.871, JSL, 5 avr. 2022, n° 539-1). La loi n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (l’une des « ordonnances Macron ») peut-elle modifier la jurisprudence à venir ? L’article L. 1235-2-1 du Code du travail précise : « En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1235-3-1 ».
De ce fait, l’examen des autres motifs n’a d’autre but que d’évaluer le préjudice et de limiter, le cas échéant, l’indemnité au minimum des six derniers mois de salaire.